Bulletin de la Société des Études Océaniennes numéro 261-262
- Titre
- Bulletin de la Société des Études Océaniennes numéro 261-262
- Description
-
Articles
-Te-ara-po : De la voix aux textes par Winston Pukoki 2
- 'Orohena ou le mont phallique 4
LE PI'I
- De la coutume du Pi'i et des modifications qu'elle apporta au vocabulaire tahitien par E. Ahnne 14
- Quelques commentaires par Marau Taaroa i Tahiti 18
- Le Pi'i, commentaires d'aujourd'hui par Louise Peltzer 28
- Les hymnologies protestantes de Tahiti et des hauts plateaux malgaches par Raymond Mesplé 36
- La crise des concepts légaux à Tahiti 1819-1838 par William Tagupa 82
- Contribution à l'histoire du droit du travail en Polynésie française par Laure Ginesty 95 - Date
- 1994
- Date de numérisation : 2017
- Format
- 6 volume au format PDF (124 vues)
- Identifiant
- PFP 3 (Fonds polynésien)
- Langue
- fre
- Editeur
- Société des Études Océaniennes (SEO)
- Relation
- http://www.sudoc.fr/039537506
- Droits
- Les copies numériques des bulletins diffusées en ligne sur Ana’ite s’inscrivent dans la politique de l’Open Data. Elles sont placées sous licence Creative Commons BY-NC. L’UPF et la SEO autorisent l’exploitation de l’œuvre ainsi que la création d’œuvres dérivées à condition qu’il ne s’agisse pas d’une utilisation commerciale.
- Source
- Société des Études Océaniennes (SEO)
- Type
- Imprimé
- Médias
-
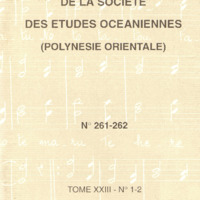 B98735210105_261-262.pdf
B98735210105_261-262.pdf
- Collections
- Bulletin de la Société des Études Océaniennes
Fait partie de Bulletin de la Société des Études Océaniennes numéro 261-262


