Bulletin de la Société des Études Océaniennes numéro 229
- Titre
- Bulletin de la Société des Études Océaniennes numéro 229
- Description
-
Articles
- Les Teva et les Pomare : P. Lagayette 1687
- L'île Christmas, l'empire de l'Abbé Rougier : C. Beslu 1695
- Littérature en Océanie : un cas de cirrhose pigmentaire atypique : D. Margueron 1712
- Cultures et cultes dans le Pacifique : W.A. Poort 1720
- Détermination botanique de quatre ti'i : C. Orliac 1739
- 5e congrès international sur les récifs coralliens à Tahiti en mai-juin 1985 . 1743
- Une nouvelle écriture océanienne : R. Koenig 1745
Compte-rendu
- J. Davies : A Tahitian and English Dictionary, Tahiti 1750
- Un défi nommé Pacifique 1753
- J.-C. Mathio : The meaning of Rural-Urban migration for French Polynesia Youth 1757
- P-A. Pirazzoli - L-F. Montaggioni : Variations récentes du niveau de l'océan
et du bilan hydrologique dans l'atoll de Takapoto 1758
- P-A. Pirazzoli : Cartographie des hauts fonds par télédétection dans l'archipel des Gambier 1759
- J.P. Ehrhardt : Les cônes venimeux de Polynésie Française 1759
La santé et la dent 1759
- Dr. Hignette Bergerard : Néphropathie hématurique familiale, avec atteinte occulaire et surdité dans une petite population isolée 1760
- I. Carloz : Action expérimentale de la ciguatoxine sur l'électrocardiogramme de chat 1760 - Date
- 1984
- Date de numérisation : 2017
- Format
- 1 volume au format PDF (80 vues)
- Identifiant
- PFP 3 (Fonds polynésien)
- Langue
- fre
- Editeur
- Société des Études Océaniennes (SEO)
- Relation
- http://www.sudoc.fr/039537501
- Droits
- Les copies numériques des bulletins diffusées en ligne sur Ana’ite s’inscrivent dans la politique de l’Open Data. Elles sont placées sous licence Creative Commons BY-NC. L’UPF et la SEO autorisent l’exploitation de l’œuvre ainsi que la création d’œuvres dérivées à condition qu’il ne s’agisse pas d’une utilisation commerciale.
- Source
- Société des Études Océaniennes (SEO)
- Type
- Imprimé
- Médias
-
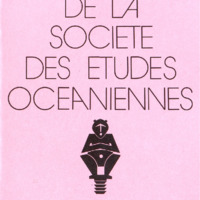 B98735210105_229.pdf
B98735210105_229.pdf
- Collections
- Bulletin de la Société des Études Océaniennes
Fait partie de Bulletin de la Société des Études Océaniennes numéro 229


