Bulletin de la Société des Études Océaniennes numéro 218
- Titre
- Bulletin de la Société des Études Océaniennes numéro 218
- Description
-
Articles
- B. Gérard, Origine traditionnelle et rôle social des marae aux îles de la société 1005
- C. Langevin-Duval, La mise en place de l'ordre missionnaire à Tahiti 1028
- Denys Choffat, Les premiers bateaux européens dans l'océan Pacifique-Est 1045
Compte-rendu
- J. Champaud, Les trucks de Tahiti 1049
- H.E. Maude, Slavers in Paradise 1050
- John Dunmore (éd.), The Expedition of the St Jean-Baptiste , 1051
- A la découverte de la musique tahitienne traditionnelle 1051 - Date
- 1982
- Date de numérisation : 2017
- Format
- 1 volume au format PDF (56 vues)
- Identifiant
- PFP 3 (Fonds polynésien)
- Langue
- fre
- Editeur
- Société des Études Océaniennes (SEO)
- Relation
- http://www.sudoc.fr/039537501
- Droits
- Les copies numériques des bulletins diffusées en ligne sur Ana’ite s’inscrivent dans la politique de l’Open Data. Elles sont placées sous licence Creative Commons BY-NC. L’UPF et la SEO autorisent l’exploitation de l’œuvre ainsi que la création d’œuvres dérivées à condition qu’il ne s’agisse pas d’une utilisation commerciale.
- Source
- Société des Études Océaniennes (SEO)
- Type
- Imprimé
- Médias
-
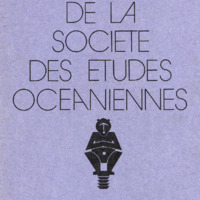 B98735210105_218.pdf
B98735210105_218.pdf
- Collections
- Bulletin de la Société des Études Océaniennes
Fait partie de Bulletin de la Société des Études Océaniennes numéro 218


