Bulletin de la Société des Études Océaniennes numéro 97
- Titre
- Bulletin de la Société des Études Océaniennes numéro 97
- Description
-
Pédagogie
- L’emploi des langues vernaculaires comme moyen d'enseignement scolaire et extra scolaire et les problèmes que pose l’enseignement en langues autres que vernaculaires dans le Pacifique du Sud, par G.J. Platten 293
- La langue maternelle, par Rey Lescure 304
Histoire
- Documents pour servir à l'histoire de Tahiti
- Document fourni par Tefaaora sur le Gouvernement des Iles Sous-le-Vent 306
- Document fourni par Maré sur le voyage de Pomare vahine 308
- L’histoire de Bora Bora et la généalogie de notre famille du marae Vaiotaha, par Tati Salmon 315
Ethnographie - Mœurs et coutumes de l'ancien Tahiti d'après le vocabulaire, par Rey Lescure 331
Dons - Dons faits à la Bibliothèque 336 - Date
- 1951
- Date de numérisation : 2017
- Format
- 1 volume au format PDF (56 vues)
- Identifiant
- PFP 3 (Fonds polynésien)
- Langue
- fre
- Editeur
- Société des Études Océaniennes (SEO)
- Relation
- http://www.sudoc.fr/039537501
- Droits
- Les copies numériques des bulletins diffusées en ligne sur Ana’ite s’inscrivent dans la politique de l’Open Data. Elles sont placées sous licence Creative Commons BY-NC. L’UPF et la SEO autorisent l’exploitation de l’œuvre ainsi que la création d’œuvres dérivées à condition qu’il ne s’agisse pas d’une utilisation commerciale.
- Source
- Société des Études Océaniennes (SEO)
- Type
- Imprimé
- Médias
-
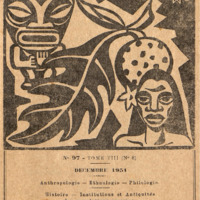 B98735210103_097.pdf
B98735210103_097.pdf
- Collections
- Bulletin de la Société des Études Océaniennes
Fait partie de Bulletin de la Société des Études Océaniennes numéro 97


