Bulletin de la Société des Études Océaniennes numéro 76
- Titre
- Bulletin de la Société des Études Océaniennes numéro 76
- Description
-
Ethnographie
- Essai de reconstitution des mœurs et coutumes de l'ancien Tahiti (3) (Rey Lescure) 191
- La coutume du " Tavau " (Rey Lescure) 196
- Têtes coupées (Jean de la Roche) 206
Littérature - "Les Immémoriaux" de Victor Segalen (H. Jacquier) 214
Folklore
- Te inu Manono ou "sur les traces du Géant Honoura" (Jay) 224
- Notes sur l'Archipel des Marquises (Rey Lescure) 231
Poésie - Le tiki (A.D.) 233
Divers.
- Départ du Président M. de Monlezun 334
- Nécrologie M. W.W. Bolton 235
- Dons et Acquisitions 235 - Date
- 1946
- Date de numérisation : 2017
- Format
- 1 volume au format PDF (52 vues)
- Identifiant
- PFP 3 (Fonds polynésien)
- Langue
- fre
- Editeur
- Société des Études Océaniennes (SEO)
- Relation
- http://www.sudoc.fr/039537501
- Droits
- Les copies numériques des bulletins diffusées en ligne sur Ana’ite s’inscrivent dans la politique de l’Open Data. Elles sont placées sous licence Creative Commons BY-NC. L’UPF et la SEO autorisent l’exploitation de l’œuvre ainsi que la création d’œuvres dérivées à condition qu’il ne s’agisse pas d’une utilisation commerciale.
- Source
- Société des Études Océaniennes (SEO)
- Type
- Imprimé
- Médias
-
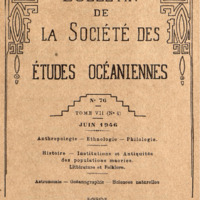 B98735210103_076.pdf
B98735210103_076.pdf
- Collections
- Bulletin de la Société des Études Océaniennes
Fait partie de Bulletin de la Société des Études Océaniennes numéro 76


