Bulletin de la Société des Études Océaniennes numéro 26
- Titre
- Bulletin de la Société des Études Océaniennes numéro 26
- Description
-
Ethnologie
I. Pêche par jet de pierres (Tautai taora ofai) par M. L. J. Bouge 73
II. La Création (Documents recueillis en 1849 Par M. Lavaud) 78
Histoire - Notes sur Huahine et autres Iles-Sous-le-Vent par R. P. Joseph Chesnau (suite et fin) 81
Folk-lore - Teiti a Toakau (Légende de Magareva) 99
Pisciculture - Truites "Arc-en-Ciel" (E. Rougier) 107
Programme - Troisième Fête du Folklore Tahitien 110 - Date
- 1928
- Date de numérisation : 2017
- Format
- 1 volume au format PDF (44 vues)
- Identifiant
- PFP 3 (Fonds polynésien)
- Langue
- fre
- Editeur
- Société des Études Océaniennes (SEO)
- Relation
- http://www.sudoc.fr/039537501
- Droits
- Les copies numériques des bulletins diffusées en ligne sur Ana’ite s’inscrivent dans la politique de l’Open Data. Elles sont placées sous licence Creative Commons BY-NC. L’UPF et la SEO autorisent l’exploitation de l’œuvre ainsi que la création d’œuvres dérivées à condition qu’il ne s’agisse pas d’une utilisation commerciale.
- Source
- Société des Études Océaniennes (SEO)
- Type
- Imprimé
- Médias
-
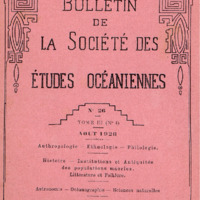 B98735210103_026.pdf
B98735210103_026.pdf
- Collections
- Bulletin de la Société des Études Océaniennes
Fait partie de Bulletin de la Société des Études Océaniennes numéro 26


