Bulletin de la Société des Études Océaniennes numéro 12
- Titre
- Bulletin de la Société des Études Océaniennes numéro 12
- Description
-
Histoire - Notice sur les Iles-Sous-Le-Vent. (X. Caillet) 23
Archéologie
- Archaeology in the Society Islands. (K. P. Emory.) 29
- Liste des Marae les mieux conservés 33
- Marae des îles Tub-uaiet'Raivavae. (Rd. P. H. Audran) 35
Membres visiteurs
- Alain Gerbault 37
- Dr H. B. Guppy 38
- Dr JOS SCHMIDT 38
Pisciculture - Notes 40
Correspondance 41
Membres de la S. E. O. 43 - Date
- 1926
- Date de numérisation : 2017
- Format
- 1 volume au format PDF (32 vues)
- Identifiant
- PFP 3 (Fonds polynésien)
- Langue
- fre
- Editeur
- Société des Études Océaniennes (SEO)
- Relation
- http://www.sudoc.fr/039537501
- Droits
- Les copies numériques des bulletins diffusées en ligne sur Ana’ite s’inscrivent dans la politique de l’Open Data. Elles sont placées sous licence Creative Commons BY-NC. L’UPF et la SEO autorisent l’exploitation de l’œuvre ainsi que la création d’œuvres dérivées à condition qu’il ne s’agisse pas d’une utilisation commerciale.
- Source
- Société des Études Océaniennes (SEO)
- Type
- Imprimé
- Médias
-
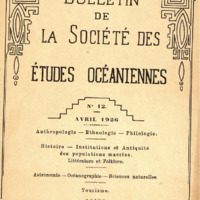 B98735210103_012.pdf
B98735210103_012.pdf
- Collections
- Bulletin de la Société des Études Océaniennes
Fait partie de Bulletin de la Société des Études Océaniennes numéro 12


