Bulletin de la Société des Études Océaniennes numéro 04
- Titre
- Bulletin de la Société des Études Océaniennes numéro 04
- Description
-
Avis important relatif aux hauts patronages du Président de la République et du Ministre des Colonies 160
Réunion du 17 avril 1918 161
Réunion du 20 août 1918 162
Pages oubliées, de M. F. X. Caillet 167
De Pitcairn à Fakarava, par Jack London, traduit de l'anglais par Outsider 182
Esquisse chronologique de l'histoire de Tahiti et des Iles de la Société, depuis les origines, par M. A. Leverd 197
Questions d'ethnologie, par M. le Prof. Macmillan Brown 213
Variétés : Bienvenue (poésie) par M. H. Michas 218
Aquarelles: Le lagon bleu. — Les teintes sombres (poésies) par M. F. Hervé 219
Nécrologie : M. le Myre de Vilers 221
Bibliothèque de la S. E. O. : Appel à MM. les Membres de la Société d'Etudes Océaniennes 222
Publications et ouvrages reçus 223 - Date
- 1918
- Date de numérisation : 2017
- Format
- 1 volume au format PDF (72 vues)
- Identifiant
- PFP 3 (Fonds polynésien)
- Langue
- fre
- Editeur
- Société des Études Océaniennes (SEO)
- Relation
- http://www.sudoc.fr/039537501
- Droits
- Les copies numériques des bulletins diffusées en ligne sur Ana’ite s’inscrivent dans la politique de l’Open Data. Elles sont placées sous licence Creative Commons BY-NC. L’UPF et la SEO autorisent l’exploitation de l’œuvre ainsi que la création d’œuvres dérivées à condition qu’il ne s’agisse pas d’une utilisation commerciale.
- Source
- Société des Études Océaniennes (SEO)
- Type
- Imprimé
- Médias
-
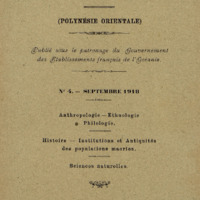 B98735210103_004.pdf
B98735210103_004.pdf
- Collections
- Bulletin de la Société des Études Océaniennes
Fait partie de Bulletin de la Société des Études Océaniennes numéro 04


